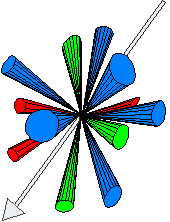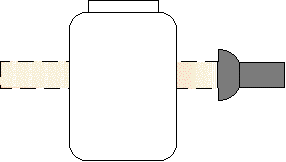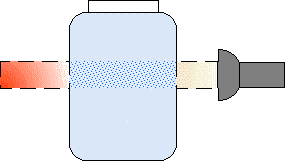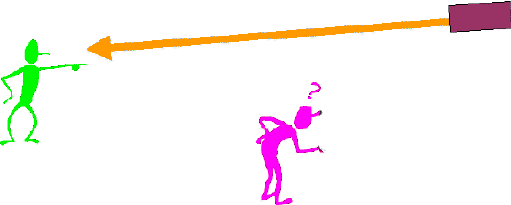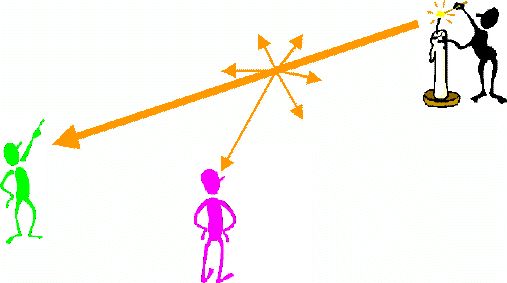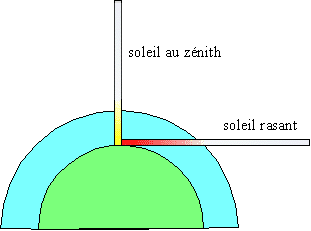|
Pourquoi
le ciel est-il bleu,
pourquoi les couchers de Soleil sont-ils rouges ?
Et
pourquoi la neige est-elle blanche ? ?
Et
les nuages, alors ? ? ? ?
|
Quelques définitions
nécessaires…
La
composition de l’atmosphère
-
L’air
qui forme notre atmosphère et qui permet à la vie de s’épanouir,
est composé principalement de molécules d’azote
(78%) et d’oxygène (21%). Il contient également du
gaz carbonique (0.01%) et de la vapeur d’eau en quantité
variable.
-
En plus des
nuages de pluie ou de neige, l’atmosphère véhicule
un très grand nombre de particules solides ou liquides.
Ces aérosols ont des origines très diverses :
poussières arrachées aux sols et aux roches, cendres volcaniques
et industrielles, pollens, microcristaux de sels issus des
océans…..
- La composition en eau, en particules
et en gaz polluants dépend évidemment beaucoup des conditions
météorologiques.
La
nature et la composition de la lumière
-
La lumière
est en fait constituée d’ondes électromagnétiques de
même nature que les ondes radio, mais de longueurs d’onde
beaucoup plus courtes. Elles sont comprises entre 0.4 et
0.8 microns (1 micron = 0.001 mm) pour la lumière " visible ",
celle du Soleil par exemple.
-
La couleur
est la sensation qui résulte de l’interaction de la
lumière avec les cellules de notre œil. A chaque longueur
d’onde est associée une sensation physiologique différente,
que l’on qualifie de " couleur " :
le violet pour les longueurs d’onde situées vers 0.4
microns, le vert vers 0.5 microns, le jaune autour de 0.55
microns, le rouge au-delà 0.6 microns.
-
Notre œil
est sensible à la lumière visible, celle du Soleil ou d’une
lampe, que nous qualifions en général de " lumière
blanche ". Celle-ci est en fait composée de plusieurs
couleurs fondamentales qui en impressionnant toutes ensembles
les cellules de notre rétine donnent cette impression de
lumière blanche. Si une ou plusieurs couleurs fondamentales
manquent, l’œil perçoit alors une couleur particulière
et non plus le blanc.
Couleurs
manquantes
|
Couleur
vue par l’œil
|
Vert, Jaune, Rouge
Bleu, Vert, Jaune
Violet, Bleu
|
Bleu
Rouge
Jaune
|
-
Une expérience
de physique classique met en évidence cette décomposition
de la lumière par un prisme. C’est le même phénomène
qui est responsable des différentes couleurs de l’arc
en ciel, ou des couleurs renvoyées par les gouttes de
rosée accrochées aux brins d’herbes ou aux fils
de la Vierge.
Propagation
de la lumière dans l’atmosphère
-
Dans le vide
de l’espace, la lumière issue par exemple d’une
lampe torche ou d’un laser se propage en ligne droite.
Jean perçoit la lumière de la lampe parce que son œil
se trouve sur le trajet du faisceau lumineux. Pierre lui
ne voit rien car il est en dehors du trajet de la lumière.
Si Pierre est un astronaute, le fond du ciel lui apparaît
noir car aucune lumière ne lui parvient, hormis celle des
points lumineux des étoiles.
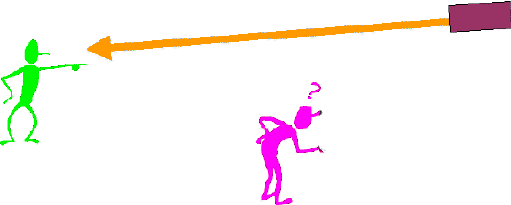
Diffusion
de la lumière
-
Dans une atmosphère
calme, transparente, de température constante la lumière
se propage aussi en ligne droite. Cependant la lumière rencontre
sur son chemin à travers l’atmosphère de nombreuses
particules microscopiques qui vont se comporter comme autant
de sources lumineuses et qui vont renvoyer la lumière dans
toutes les directions et en particulier vers notre œil.
On dit qu’il y a diffusion de la lumière.
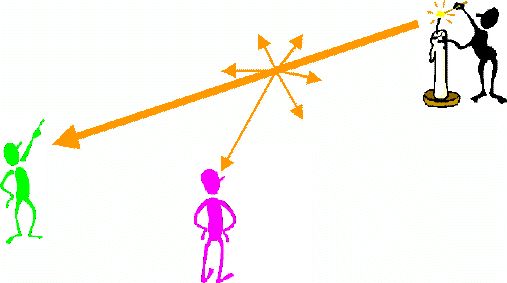
-
Alors que dans
le vide Pierre ne percevait aucune lumière, dans l’atmosphère
il voit maintenant la lumière diffusée par les molécules
et les particules de l’air. C’est ce phénomène
qui explique que la nuit, on puisse voir le faisceau d’une
lampe torche puissante, ou les faisceaux lasers d’une
discothèque, même si ces faisceaux ne sont pas dirigés vers
nous.
-
Cependant il
existe plusieurs types de diffusion car les propriétés
de la lumière diffusée dépendent essentiellement de la taille
des particules diffusantes. De nombreux phénomènes observés
dans la nature ou dans la vie de tous les jours s’expliquent
en faisant intervenir la diffusion.
|
La
couleur du ciel.
-
Les
molécules de l’air sont les objets diffusants les plus
petits de l’atmosphère. Elles sont beaucoup plus petites
que les longueurs d’onde qui caractérisent la lumière
(dimension de l’ordre de 0.001 micron, à comparer aux
longueurs d’onde des couleurs visibles : violet :
0,4 microns ; rouge :0,8 microns). La diffusion
correspondante est appelée diffusion Rayleigh. L’intensité
de la lumière diffusée est d’autant plus grande que
la longueur d’onde de la lumière est plus courte :
les radiations bleues sont diffusées beaucoup plus efficacement
que les radiations rouges ou même que les vertes.
[Avec
quelques gouttes de lait, vous pourrez facilement réaliser
l’expérience décrite ci-dessous et qui illustre parfaitement
ce phénomène].
|
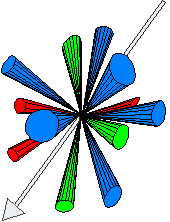 |
-
La
lumière diffusée par l’atmosphère contient donc beaucoup
plus de radiations bleues que de radiations rouges :
l’œil perçoit alors une couleur bleue intense
caractéristique d’un ciel pur.
-
Cette
explication demande à être complétée. En effet la lumière
violette, dont les longueurs d’onde sont encore plus
courtes que celles de la lumière bleue est diffusée encore
plus efficacement que la lumière bleue. On devrait donc
s’attendre à voir un ciel violet. En fait, la sensibilité
de l’œil est infiniment plus faible dans le violet
que dans le bleu. C’est donc cette dernière couleur
qui est vue par l’œil.
|
 |
|
La
couleur du Soleil.
Si
la lumière diffusée est riche en radiations bleues, c’est
bien sûr aux dépens de la lumière transmise. Celle-ci contient
donc beaucoup plus de lumière orange ou rouge que de lumière
bleue, et ce déficit en lumière bleue est d’autant plus
important que le trajet dans l’atmosphère est plus grand.
Le Soleil apparaît très blanc aux astronautes ; mais
vu du sol, il a une couleur jaune quand il est au zénith.
Quand il baisse sur l’horizon, il devient même de plus
en plus rouge car sa lumière traverse alors une épaisseur
d’atmosphère de plus en plus grande.

|
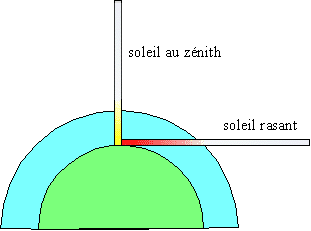
|
|
La
couleur des nuages
-
La
couleur bleue du ciel est donc due à la diffusion par les
molécules de l’air dont les dimensions sont beaucoup
plus petites que la longueur d’onde des radiations
lumineuses auxquelles notre œil est sensible. Si les
particules diffusantes ont des dimensions nettement supérieures,
on observe encore un phénomène de diffusion, dont les propriétés
sont différentes : cette fois, toutes les couleurs
sont diffusées de la même façon, les particules renvoient
donc dans toutes les directions, et en particulier vers
notre œil, une lumière identique à la lumière incidente.
-
Les
nuages étant composés de gouttelettes d’eau ou de cristaux
de glace de dimensions microscopiques (quelques microns)
mais cependant nettement supérieures aux longueurs d’onde
de la lumière, ils vont diffuser également toutes les couleurs
de la lumière du Soleil et vont donc apparaître blancs.
Ceci est vrai pour tous les nuages vus d’avion. Au
sol, les nuages de taille moyenne sont également blancs ;
par contre, les très gros nuages vus par dessous vont apparaître
gris ou même presque noirs car ils sont tellement épais
que pratiquement plus aucune lumière n’arrive à les
traverser.
-
L’opacité
du brouillard est due au même phénomène : la diffusion
est tellement efficace que plus aucun rayon lumineux provenant
d’un objet n’arrive directement à l’œil ;
les images s’estompent et disparaissent même complètement
quand le brouillard est très épais ; on ne voit plus
qu’une lumière diffuse blanche.
|
 |
Les
couleurs des levers et couchers de Soleil
-
Nous
connaissons maintenant suffisamment de choses pour expliquer
les couleurs souvent extraordinaires des levers et couchers
de Soleil. Quand
le Soleil est bas sur l’horizon, sa lumière est riche
en couleurs oranges et rouges puisque au cours de la traversée
d’une grande épaisseur d’air, elle a perdu par
diffusion la plus grande partie des couleurs bleues et vertes
(figure 4). Les nuages qui diffusent cette lumière dans
toutes les directions vont donc renvoyer vers notre œil
toute une palette de teintes rouge-orangé caractéristiques.
|

|
La
couleur de la neige
-
Alors
que la glace est transparente, il peut apparaître étonnant
que la neige ne le soit pas et qu’elle apparaisse au
propre comme au figuré comme l’exemple même de la blancheur.
Là
encore l’explication vient du phénomène de diffusion.
La neige est en effet composée d’une multitude de microcristaux
de glace dont les facettes renvoient la lumière blanche
du Soleil dans toutes les directions. Comme dans le cas
du brouillard, plus aucun rayon lumineux ne peut traverser
la neige sans être diffusé par ces cristaux. Puisque chaque
micro-cristal de glace pris individuellement est transparent
, la lumière n’est pas atténuée par son trajet dans
la neige : la lumière qui est transmise ou diffusée
par une neige éclairée par le Soleil est d’une blancheur
intense. Par contre, au lever ou au coucher, le Soleil bas
sur l’horizon éclaire la neige de teintes rouge-orangé.
La neige, puisqu’elle diffuse intégralement la lumière
qu’elle reçoit, prend alors des teintes remarquables
bien connues des alpinistes.
|
 |
Une
expérience facile à réaliser avec des objets de la vie courante.
Couleur
du ciel et des couchers de Soleil
Matériel
- Un gros bocal à
confiture. L'expérience a très bien marché avec des bocaux à conserves
de 1 litre (diamètre environ 10 cm, hauteur 15 cm).
- Une lampe torche
ou une frontale dont on peut régler l'étendue du faisceau.
- Quelques gouttes
de lait.
Montage et interprétation.
- Remplir le bocal
d'eau pure. Se placer dans une pièce sombre ou opérer le soir. Après
avoir réglé la lampe pour avoir un faisceau très concentré, éclairer
par le coté suivant le schéma ci-contre.
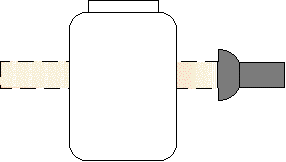
- Observer que le trajet du faisceau de la lampe n'est
pas visible dans l'eau. Dans un milieu parfaitement transparent, il
n'y a pas de diffusion de la lumière.
- Ajouter du lait
en faible quantité ; 50 à 70 gouttes mesurées avec
un doseur pharmaceutique est un bon compromis. Cette fois on observe
distinctement le trajet du faisceau lumineux dans l'eau.
L'eau contient maintenant des molécules
de lait qui se comportent comme autant de sources lumineuses microscopiques
et qui renvoient la lumière vers notre œil.
Mais le plus remarquable
est que tout le bocal est entièrement baigné par une
lumière diffuse bleu pâle.
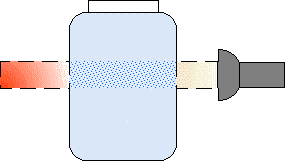
La
dimension des molécules de lait sont très petites devant
les longueurs d'onde caractéristiques de la lumière visible.
Les molécules diffusent préférentiellement les
longueurs d'onde courtes comme le bleu. La lumière diffusée
est donc riche en teintes bleues. Cette lumière bleutée
est de même nature que celle qui donne au ciel sa couleur bleue.
- Regarder la lampe
à travers le bocal. La lumière qui parvient à l'œil
est maintenant beaucoup plus orangée que celle de la lampe regardée
directement. L'effet est encore plus net si on éclaire le bocal
par dessous.
- La lumière
transmise à travers l'eau lactée a perdu par diffusion
la plus grande partie de ses composantes bleues. Elle a donc une teinte
jaune orangé. Plus le trajet dans l'eau lactée est grand
et plus cette perte en bleu est importante ; l'effet est donc plus marqué
quand l'épaisseur d'eau traversée augmente. C'est le même
phénomène qui donne aux couchers de Soleil leurs teintes
si caractéristiques.
-
- L'expérience
est plus démonstrative si l'on dispose de deux bocaux, l'un avec
de l'eau pure et l'autre avec les gouttes de lait, et si l'on passe
alternativement de l'un à l'autre afin de faire les comparaisons
eau pure/eau lactée en " temps réel ".
|